Psychopharmacologie pratique
28 juillet 2025
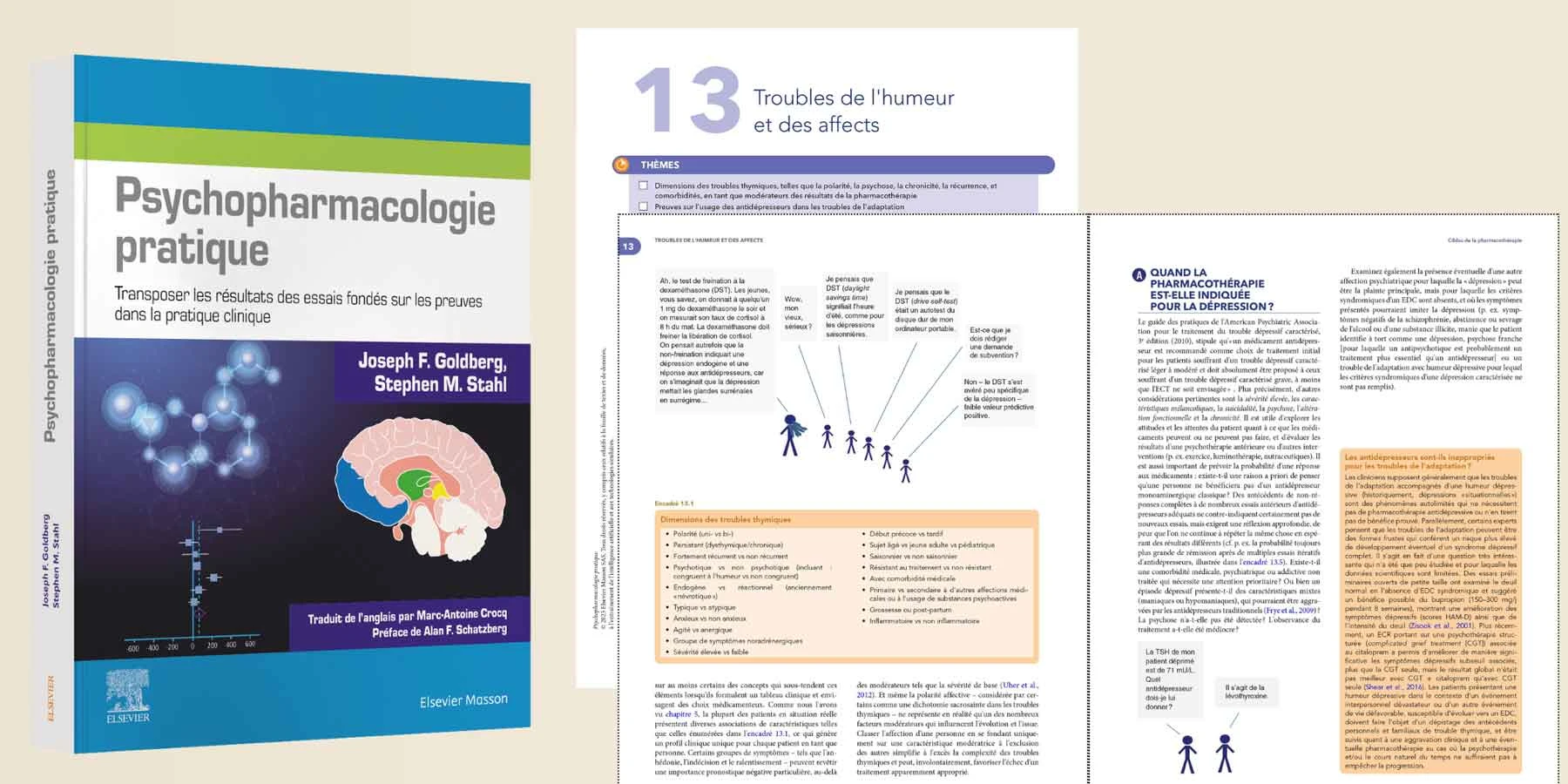
Nouvel ouvrage de J.F. GOLDBERG et S.M. STAHL
Psychopharmacologie pratique est un guide pratique d’aide à la décision pour tous les praticiens qui prescrivent des psychotropes.
Découvrez le sommaire et la préface et le début du chapitre 13, Troubles de l'humeur et des affects.
Toutes nos publications sont sur elsevier-masson.fr
Sommaire
Avant-propos Préface Abréviations
Partie I Principes généraux
1. Les fondamentaux d'une bonne psychopharmacologie 2. Cibles du traitement : catégories versus dimensions de la psychopathologie 3. Interpréter et utiliser la littérature : intégrer les essais fondés sur des preuves dans la pratique réelle 4. Effets placebo et nocebo 5. Traitement sur mesure : modérateurs et médiateurs 6. Prescriptions complexes et associations médicamenteuses rationnelles 7. Examens de laboratoire et symptômes psychiatriques : ce qu'il faut mesurer ou ne pas mesurer et que faire des résultats 8. Pharmacogénétique : pertinente ou non ? 9. Substitution et arrêt progressif des médicaments 10. Gestion des effets indésirables majeurs des médicaments : quand les éviter, changer de médicaments ou traiter malgré tout 11. Nutraceutiques, stéroïdes, probiotiques et autres compléments alimentaires 12. Diversité humaine et prise en compte des populations particulières
Partie II Cibles de la pharmacothérapie
13. Troubles de l'humeur et des affects 14. Troubles de l'impulsivité, de la compulsivité et de l'agressivité 15. Psychose 16. Etats déficitaires et symptômes négatifs 17. Anxiété 18. Addiction et circuit de récompense 19. Traumatisme et trouble de stress post-traumatique 20. Troubles et traits de la personnalité 21. Cognition 22. Tout combine
Références Index.
Préface des auteurs
L'idée de ce livre est née de notre perception d'un besoin visible non satisfait dans le monde de la psychopharmacologie clinique, celui d'un mariage entre les neurosciences cliniques et les essais fondés sur les preuves, avec le pragmatisme comme entremetteur. Il existe, d'une part, une littérature sans cesse croissante d'essais contrôlés randomisés, d'essais croisés, de séries de cas ouvertes, d'études de validation de concept et de rapports de cas qui soutiennent à des degrés divers des stratégies thérapeutiques novatrices; d'autre part, il existe une réalité clinique dans laquelle les patients commencent et arrêtent fréquemment des médicaments, pas toujours pour des raisons impérieuses, où les praticiens prennent en charge des patients avec des polypharmacies lourdes qui peuvent parfois ressembler à des assemblages aléatoires, où les justifications pharmacodynamiques ne sont pas toujours pertinentes, où les mécanismes d'action peuvent être involontairement redondants ou contradictoires, et où les traitements inefficaces peuvent être conservés (parfois même accumulés) sans raison au lieu d'être déprescrits.
Simultanément, il y a souvent un décalage entre les diagnostics précis inclus dans les essais randomisés à grande échelle menés par l'industrie et les tableaux cliniques souvent plus mal définis que de nombreux cliniciens rencontrent dans la vie réelle, dans des contextes de traitement non spécialisés. Alors que les spécialistes des essais cliniques s'efforcent de déterminer si chaque sujet potentiel de recherche répond pleinement aux critères diagnostiques de symptomatologie et de durée du DSM-5 ou de la CIM-10, sur la base d'un entretien clinique structuré et détaillé – souvent en tenant compte de la présence de nombreux troubles concomitants –, les praticiens du monde réel manquent généralement de temps, de ressources et souvent de formation pour appliquer des critères diagnostiques rigoureux afin de déceler ou d'exclure des troubles catégoriels bien définis.
Pour plus de confusion, l'Institut national de la santé mentale (NIMH) a choisi en 2013 d'abandonner complètement les catégories diagnostiques du DSM-5 et leurs critères d'inclusion ou d'exclusion, en privilégiant un cadre plus dimensionnel que catégoriel, censé refléter les processus neurobiologiques sous-jacents présumés. Il n'a jamais été aussi difficile de poser des diagnostics « exacts » en raison de l'évolution des idées sur ce qui constitue un véritable diagnostic évolue dans sa réflexion sur ce qui constitue une véritable entité clinique et sur les cibles thérapeutiques qui en découlent. Dans une sorte de processus parallèle étrange, la classification traditionnelle des médicaments psychotropes est de plus en plus critiquée, à cause des résultats d'études contrôlées et observationnelles (telles que STAR*D et CATIE), et de l'évolution des hypothèses sur les processus pathologiques et les mécanismes des médicaments qui rendent obsolètes les théories simplistes sur les «déséquilibres » des neurotransmetteurs. Les médicaments autrefois appelés antidépresseurs semblent ne pas traiter la dépression de manière fiable et solide, les médicaments appelés antipsychotiques traitent plus que la psychose, certains médicaments pour la pression artérielle ont trouvé une nouvelle vie dans le traitement des symptômes de l'anxiété et du trouble de stress post-traumatique, et (au moins certains) anticonvulsivants possèdent des propriétés psychotropes variées indépendantes de leur efficacité antiépileptique. De nouvelles propriétés psychotropes sont reconnues à d'anciens médicaments (tels que la prazosine, la kétamine, l'isradipine, la scopolamine, les anti-inflammatoires et les immunomodulateurs), tandis que de nouvelles thérapies ont suscité un intérêt croissant pour de nouveaux mécanismes d'action potentiels (comme la modulation des récepteurs opiacés pour la dépression [p. ex. buprénorphine], le blocage des récepteurs 5HT2A pour la psychose [p. ex. pimavansérine], la modulation du GABA et les neurostéroïdes de 2e génération pour la dépression du postpartum [p. ex. brexanolone], et l'inhibition du VMAT2 pour les troubles du mouvement [p. ex. valbénazine, deutétrabénazine]), parmi d'autres stratégies thérapeutiques novatrices.
Les praticiens très surchargés ont souvent du mal à se tenir au courant de la littérature. Ils peuvent être peu familiarisés avec les données qui soutiennent ou réfutent certains choix médicamenteux dans des contextes particuliers, et ils peuvent choisir des médicaments pour leurs effets prévus ou espérés sur des symptômes spécifiques (tels que l'inattention, l'agressivité impulsive, l'anxiété ou l'insomnie) plutôt que sur des constellations cohérentes de signes et de symptômes qui forment une entité distincte et reconnaissable. Lorsque les présentations cliniques sont ambiguës sur le plan diagnostique, on est souvent tenté de coller de force une étiquette diagnostique globale (et remboursable) sur des patients dont les problèmes ne sont peut-être tout simplement pas bien pris en compte par la nomenclature existante. Pendant ce temps, les neuroscientifiques cliniques s'intéressent aux mécanismes putatifs d'action des médicaments, aux circuits cérébraux pertinents pour les phénotypes cliniques et aux éventuelles considérations pharmacogénétiques qui pourraient un jour aider significativement à affiner la médecine de précision au cas par cas.
Ce livre cherche à combler les nombreux fossés qui existent aujourd'hui entre les activités de la pratique clinique quotidienne et les résultats des études scientifiques, entre le langage de la neuropharmacologie et celui des interventions ciblées sur les symptômes, entre les approches systématiques des pharmacothérapies itératives et synergiques et l'accumulation de polypharmacies irrationnelles et exagérées. Dans les pages qui suivent, notre objectif est d'articuler une approche scientifiquement informée de la psychopharmacologie clinique, en dégageant des informations généralisables à partir d'essais cliniques de manière à faciliter le processus d'extrapolation de la base de données des essais cliniques à la pratique quotidienne. D'une certaine manière, cette fusion conceptuelle invite le praticien à assumer le rôle de l'expérimentateur clinique, en considérant chaque patient comme un sujet pour lequel des symptômes cibles sont objectivés, des résultats sont suivis et des raisonnements forment la base des décisions concernant les thérapies médicamenteuses.
Nous espérons également réorienter l'attention du clinicien en l'éloignant du concept non scientifique de l'approbation ou non d'un médicament par la FDA pour une affection particulière, en tant que principe organisateur de la prise de décision pharmacologique. Bien que le processus d'approbation réglementaire des médicaments fournisse un service public pour l'assurance de la qualité de la fabrication et de l'innocuité des produits, il s'agit fondamentalement d'une entreprise guidée davantage par des intérêts commerciaux que par les neurosciences. Au mieux, elle applique des concepts neuroscientifiques dans le but d'étayer une allégation pharmacodynamique ou pharmacocinétique concernant la pertinence d'une substance donnée pour un usage particulier. L'approbation réglementaire signifie que les fabricants de produits pharmaceutiques ont l'autorisation légale de faire la publicité d'une substance brevetée ; elle n'est pas fondée sur la volonté de faire progresser les connaissances sur le fonctionnement du cerveau. De nombreuses substances génériques non brevetées ont des raisons plausibles d'être utilisées dans des situations cliniques particulières, mais ce statut « hors AMM» ne signifie rien quant à l'existence ou non d'une base de données scientifique. Le carbonate de lithium et l'hormone thyroïdienne sont tous deux des exemples de stratégies d'appoint fondées sur des preuves pour le traitement de la dépression résistante, mais ni l'un ni l'autre n'a reçu ou ne recevra probablement jamais l'autorisation des agences réglementaires à cette fin, à moins qu'un intérêt commercial n'invente une nouvelle formulation ou un nouveau mode d'administration breveté qui pourrait assurer la rentabilité de l'investissement considérable nécessaire au développement d'un produit. L'industrie se concentre sur les produits brevetés pour lesquels une part de marché lucrative est attendue ; les cliniciens, quant à eux, étudient si une molécule exerce ou non un effet pharmacodynamique ou pharmacocinétique notable sur un ensemble définissable de signes et de symptômes.
Dans certains milieux, on pense que la prise de décision en matière de pharmacothérapie est en grande partie un processus d'essais et d'erreurs, avec peu ou pas d'indications provenant de paramètres scientifiquement significatifs pour éclairer les choix de traitement. Les cyniques soulignent souvent l'absence relative de mesures de laboratoire pour évaluer le succès d'un traitement; il n'y a pas d'équivalent de la charge virale, de la numération des globules blancs, de la charge tumorale ou de la fraction d'éjection pour suivre l'impact d'un traitement donné sur la trajectoire d'un processus pathologique. Pourtant, les critères cliniques de mesure du succès ne sont pas différents de ceux utilisés dans d'autres spécialités pour évaluer les changements longitudinaux dans des affections dépourvues de biomarqueurs, comme lorsque les neurologues jugent de l'amélioration des céphalées chroniques (ou de l'atténuation de la douleur en général), que les spécialistes de la médecine du sommeil jugent de l'efficacité du traitement de la narcolepsie ou que les oto-rhino-laryngologistes tentent d'améliorer les acouphènes. Même les ophtalmologues s'appuient sur l'autoévaluation de l'acuité visuelle perçue par le patient lorsqu'ils testent des verres correcteurs. La santé mentale n'est pas moins tangible que les autres fonctions cérébrales.
Si l'on soutient que la psychopharmacologie itérative est une entreprise d'essais et d'erreurs, nous répliquerons que la notion de « supposition raisonnée » est plus proche de la véritable nature d'une prise de décision éclairée (plutôt qu'aléatoire). À l'instar du jeu de société de la «bataille navale », dans lequel les mouvements successifs contre un adversaire sont effectués sur la base des connaissances acquises à partir des résultats des manœuvres précédentes, les décisions concernant « le prochain médicament à essayer » après une réponse insuffisante à une intervention donnée devraient faire l'objet d'une analyse bayésienne – c.-à-d. fondée sur la sagesse acquise à partir des efforts passés et des raisons probables des mauvais résultats (p. ex. les intolérances aux médicaments, la non-observance, un mauvais ciblage des symptômes ou un spectre d'action trop étroit, etc.). Et, comme un bon joueur d'échecs, on réfléchit toujours aux implications possibles d'une prescription sur les étapes suivantes.
Le livre est divisé en deux parties principales. La première aborde les grands concepts fondamentaux qui guident la prise de décision en psychopharmacologie, notamment :
définir des principes fondés sur des preuves
lire et interpréter la littérature sur les essais cliniques, et comprendre la conception des études, la taille des effets, les effets placebos et les moyens d'extrapoler les résultats des essais cliniques à la pratique courante
comprendre les dimensions versus les catégories de la psychopathologie en tant que « véritables » cibles de la pharmacothérapie, telles que décrites dans les Research Domain Criteria (RDoC) du NIMH
comprendre les effets pharmacodynamiques tels qu'ils sont décrits dans la nomenclature évolutive fondée sur les neurosciences (NbN)
tenir compte des interactions médicamenteuses et des stratégies de substitution progressive des médicaments
reconnaître quand la surveillance des paramètres biologiques ou d'autres organes terminaux est ou n'est pas pertinente d'un point de vue clinique
reconnaître les modérateurs et les médiateurs des résultats thérapeutiques spécifiques au patient qui peuvent aider à personnaliser les protocoles thérapeutiques
élaborer des schémas logiques et stratégiques d'association de médicaments
connaître les points forts et les limites des tests pharmacogénétiques
En ce qui concerne la pharmacothérapie, nous avons le sentiment que les cabinets de consultation débordés ont trop souvent tendance à tirer d'abord et à poser des questions ensuite – en d'autres termes à formuler des impressions diagnostiques rapides, puis à laisser libre cours aux stratégies médicamenteuses qui semblent les plus opportunes pour maîtriser les symptômes les plus gênants. Nous préférons une approche plus équilibrée et calculée dans la lutte contre la psychopathologie, dans laquelle le chasseur évalue furtivement sa proie, se familiarise avec ses habitudes, ses comportements et ses caractéristiques pertinentes, s'assure que la cible a été correctement identifiée, choisit l'armement approprié pour la tâche à accomplir, vise soigneusement avant d'appuyer sur la gâchette, puis intervient avec une précision chirurgicale et le moins de dommages collatéraux possible. L'adage de Sir Francis Bacon, « soigner la maladie et tuer le patient », n'a pas sa place dans notre concept de psychopharmacologie sophistiquée. Bien que notre connaissance des mécanismes des maladies et des effets des traitements reste primitive à bien des égards, la maxime primum non nocere reste primordiale.
Il est impossible pour un psychiatre, aussi motivé et avisé soit-il, d'appréhender l'ensemble croissant des résultats de recherche pertinents. Avec des centaines, voire des milliers d'articles cliniques intéressants publiés chaque année, avec le défi de juger de la qualité, de la pertinence, de la crédibilité et de distinguer ce qui est convaincant de ce qui est fallacieux, le volume d'informations est écrasant. De notre point de vue, il est plus utile de savoir où trouver l'information et comment appliquer les nouvelles connaissances au fur et à mesure qu'elles apparaissent, plutôt que d'imaginer que le corpus d'informations judicieuses peut être trouvé dans un seul lieu. Ce livre n'a en aucun cas l'ambition de présenter toutes les bribes possibles des connaissances actuelles (dont la demi-vie est en soi incertaine), mais s'efforce plutôt de donner au lecteur le sentiment qu'il peut se tenir au courant et mettre en pratique au quotidien les principes de base de la médecine fondée sur des preuves. La phrase « je ne sais pas, mais je peux chercher » est une affirmation favorite et valorisante à dire aux patients, aux stagiaires et surtout à nous-mêmes; plus qu'une marque d'humilité, elle transmet un dédain pour les suppositions. Savoir où et comment trouver et appliquer des informations exactes est l'un des nombreux secrets de la psychopharmacologie que nous avons essayé de partager dans les pages qui suivent.
La deuxième partie de cet ouvrage fournit des détails et des informations spécifiques sur les justifications et les fondements scientifiques d'interventions spécifiques. Nous cherchons à nous concentrer sur les cibles thérapeutiques décrites dans la première partie, en nous appuyant sur leurs bases cliniques et neuroscientifiques, ainsi que sur les dimensions de la psychopathologie en tant que phénomènes transdiagnostiques (p. ex. problèmes d'attention, de contrôle des impulsions, d'humeur, de motivation, de perception, d'anxiété et d'automutilation). Dans l'ensemble, notre objectif est de nous appuyer sur la littérature des essais cliniques fondés sur des preuves et de traduire les résultats en enseignements pragmatiques pour le praticien occupé. Souvent, cela s'est avéré plus difficile que nous ne l'aurions souhaité, en particulier lorsque les caractéristiques de nos patients ne ressemblent que très peu à celles des sujets d'étude. Tout comme les généticiens qui tentent de reconstruire le génome d'une espèce disparue doivent parfois « compléter » les parties manquantes de l'ADN avec des données provenant d'une espèce voisine, nous avons essayé d'utiliser la logique et l'extrapolation pour étendre notre champ d'action dans le domaine clinique, en appliquant les connaissances sur le connu à l'inconnu afin de prendre des décisions judicieuses dans la gestion de tableaux psychiatriques complexes.
Comment présenter au mieux toutes les informations contenues dans ce texte d'une manière conviviale et cliniquement pragmatique ? Les détails sont incontournables lorsqu'il s'agit de discuter des preuves pour une affection psychiatrique donnée. Notre stratégie a consisté à rendre le processus aussi attrayant et indolore que possible pour le lecteur grâce à un texte vivant, des cas illustratifs, des figures, une multitude de bandes dessinées, de nombreux encadrés « astuce » et des faits intéressants tout au long du parcours. Les tableaux détaillés qui résument de grandes quantités d'informations apparaissent délibérément à la fin de chaque chapitre plutôt que dispersés à l'intérieur – ce qui permet à ceux qui veulent approfondir de le faire, sans rompre le flux narratif pour ceux qui préfèrent avoir une vision d'ensemble. Nous sommes tous deux profondément attachés à la manière dont les cliniciens apprennent, ainsi qu'à ce qu'ils apprennent. Il n'est pas facile de rester engagé dans une matière complexe. Nous espérons que notre approche stimulera avec succès les circuits paralimbiques «oh wow! » et le « raisonnement clinique » chez tous les apprenants.
Nous avons tous deux eu la chance de connaître et de travailler avec de nombreux collègues, mentors, élèves et patients qui, de diverses manières, nous ont apporté la curiosité, l'inspiration et la stimulation nécessaires pour entreprendre ce projet. Nous sommes particulièrement reconnaissants à nos nombreux collègues qui ont eu la gentillesse de lire des parties de ce livre en cours d'élaboration et qui nous ont fait part de leurs commentaires utiles. Enfin, nous ne saurions exprimer toute notre gratitude à nos familles, qui ont soutenu avec tant de gentillesse et d'abnégation nos efforts professionnels et notre volonté inhérente d'éduquer, de faire progresser les connaissances et d'offrir à nos patients les meilleurs soins possibles.
Lire le début du chapitre 13 Troubles de l'humeur et des affects

Troubles de l'humeur et des affects
Lire le début du chapitrePsychopharmacologie pratique Transposer les résultats des essais fondés sur les preuves dans la pratique clinique Stephen M. Stahl, Joseph F. Goldberg, Marc-Antoine Crocq ISBN 9782294781988 2025
Toutes nos publications sont sur elsevier-masson.fr
