Les hypocalcémies
11 août 2025
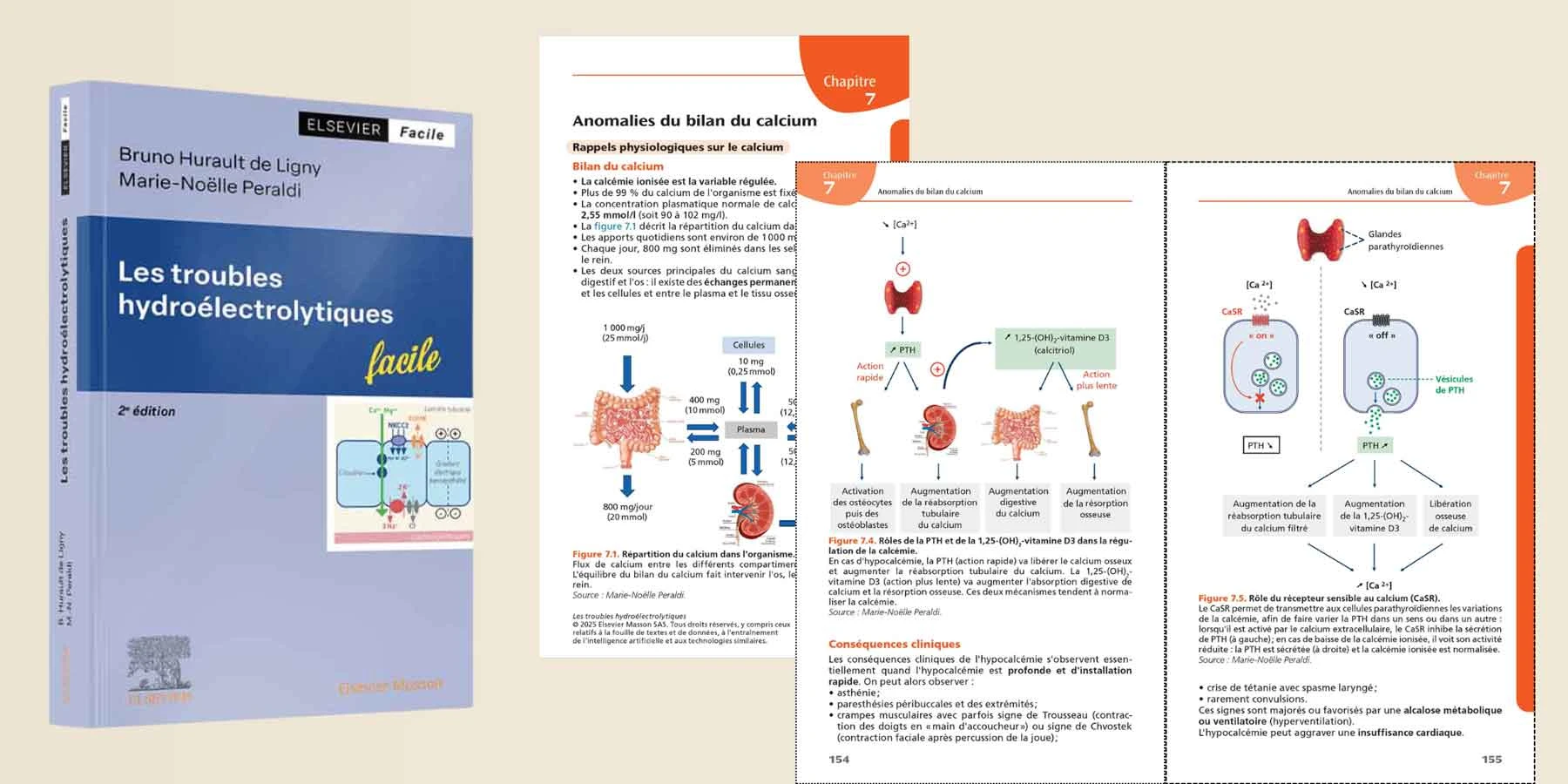
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les troubles hydroélectrolytiques !
Nous vous proposons de découvrir un extrait du chapitre 7 Anomalies du bilan du calcium de l'ouvrage Les troubles hydro-électrolytiques faciles
:
Définition
L’hypocalcémie est définie par une calcémie totale < 2,25 mmol/l.
Seules les hypocalcémies ionisées ( ≤ 1,10 mmol/l) ont des conséquences cliniques.
Tableau 7.1. Principaux facteurs influençant la calcémie. Cliquez ici pour agrandir le tableau 7.1.
Figure 7.4. Rôles de la PTH et de la 1,25-(OH)2-vitamine D3 dans la régulation de la calcémie. En cas d'hypocalcémie, la PTH (action rapide) va libérer le calcium osseux et augmenter la réabsorption tubulaire du calcium. La 1,25-(OH)2-vitamine D3 (action plus lente) va augmenter l'absorption digestive de calcium et la résorption osseuse. Ces deux mécanismes tendent à normaliser la calcémie. Source : Marie-Noëlle Peraldi.
Conséquences cliniques
Les conséquences cliniques de l’hypocalcémie s’observent essentiellement quand l’hypocalcémie est profonde et d’installation rapide. On peut alors observer :
asthénie ;
paresthésies péribuccales et des extrémités ;
crampes musculaires avec parfois signe de Trousseau (contraction des doigts en « main d’accoucheur ») ou signe de Chvostek (contraction faciale après percussion de la joue) ;
crise de tétanie avec spasme laryngé ;
rarement convulsions.
Ces signes sont majorés ou favorisés par une alcalose métabolique ou ventilatoire (hyperventilation). L’hypocalcémie peut aggraver une insuffisance cardiaque. Une hypocalcémie aiguë sévère peut menacer le pronostic vital.
Figure 7.5. Rôle du récepteur sensible au calcium (CaSR). Le CaSR permet de transmettre aux cellules parathyroïdiennes les variations de la calcémie, afin de faire varier la PTH dans un sens ou dans un autre : lorsqu'il est activé par le calcium extracellulaire, le CaSR inhibe la sécrétion de PTH (à gauche) ; en cas de baisse de la calcémie ionisée, il voit son activité réduite : la PTH est sécrétée (à droite) et la calcémie ionisée est normalisée. Source : Marie-Noëlle Peraldi.
L'ECG (électrocardiogramme) peut mettre en évidence :
un allongement de l'intervalle QT le plus souvent asymptomatique (figure 7.6) ;
parfois des ondes T amples et pointues ;
une bradycardie, voire un bloc auriculoventriculaire.
Figure 7.6. QT long chez un patient dont la calcémie ionisée est à 0,8 mmol/L Source : Marie-Noëlle Peraldi.
Examens utiles
Examens utiles devant une hypocalcémie selon le contexte clinique :
calcémie totale et albuminémie ;
calcémie ionisée ;
créatininémie ;
phosphatémie ;
magnésémie ;
PTH ;
25-(OH)-vitamine D ;
1,25-(OH) 2 -vitamine D3 ;
calciurie des 24 heures ;
ECG.
Étiologie
D’une manière schématique, les mécanismes de l’hypocalcémie résultent :
soit d’une augmentation des « pertes » de calcium hors du secteur vasculaire : - dépôts tissulaires ; - transferts osseux ; - pertes urinaires ; - chélation intravasculaire ;
soit d’une diminution des entrées plasmatiques de calcium : - malabsorption intestinale ; - diminution de la résorption osseuse.
Le tableau 7.2 résume les principales causes d’hypocalcémie et les signes biologiques associés.
Tableau de synthèse
Les principales situations cliniques avec hypocalcémie sont résumées dans le tableau 7.3 . L’analyse de la calcémie, de la phosphatémie, de la PTH et de la 25-(OH)-vitamine D permet le plus souvent d’aboutir à un diagnostic.
Tableau 7.3. Principales causes d'hypocalcémie et anomalies biologiques associées.
Traitement
Le traitement des hypocalcémies repose sur :
les apports de calcium per os (carbonate de calcium le plus souvent) : 500 mg à 1,5 g par jour ;
les apports de calcium par voie veineuse en cas d’hypocalcémie symptomatique: - gluconate de calcium : 1 ampoule contient 2,3 mmol de calcium-élément pour 10 ml ; - chlorure de calcium : 1 ampoule contient 4,5 mmol de calcium-élément pour 10 ml (apports plus importants et action plus rapide) ;
la correction d’une carence en vitamine D définie par un dosage de 25-(OH)- vitamine D < 30 ng/ml : - vitamine D2 (ergocalciférol , Stérogyl©) ; - ou vitamine D3 (cholécalciférol , Uvedose©) ;
l’apport de vitamine D hydroxylée (Un-Alfa©, Rocaltrol©) : - en cas d’insuffisance rénale chronique et en l’absence d’hyperphosphatémie ; - en cas d’hypoparathyroïdie après thyroïdectomie totale ; l'objectif est ici de maintenir une calcémie modérément basse qui ne soit pas symptomatique, sans viser une calcémie normale qui expose au risque d'hypercalciurie, de lithiase et de néphrocalcinose. Si l'hypoparathyroïdie est réfractaire, on peut avoir recours à des injections de PTH recombinante (Natpar®)
la correction d’une hypomagnésémie si besoin.
Enfin, au cours des rhabdomyolyses, la correction d’une hypocalcémie doit être prudente car il existe souvent une hypercalcémie à la phase de récupération du fait de mobilisation des dépôts calciques intramusculaires.
Les troubles hydroélectrolytiques © 2025 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés, y compris ceux relatifs à la fouille de textes et de données, à l'entraînement de l'intelligence artificielle et aux technologies similaires.
Vous venez de découvrir un extrait de l'ouvrage Les troubles hydro-électrolytiques faciles
Bruno Hurault de Ligny est ancien professeur des Universités et praticien hospitalier dans le service de néphrologie, dialyse et transplantation rénale au CHU de Caen. Marie-Noëlle Peraldi est professeur des Universités et praticien hospitalier dans le service de néphrologie et transplantation rénale à l’hôpital Necker à Paris.
Les troubles hydroélectrolytiques Marie-Noëlle Peraldi, Bruno Hurault de Ligny ISBN 9782294788598 2e édition, 2025






